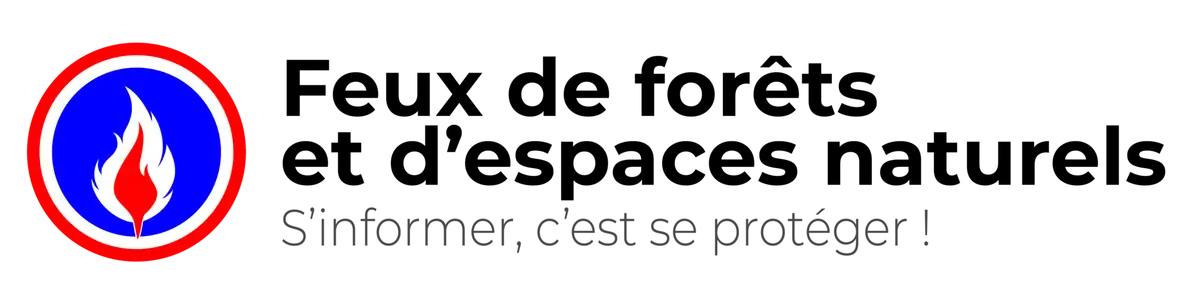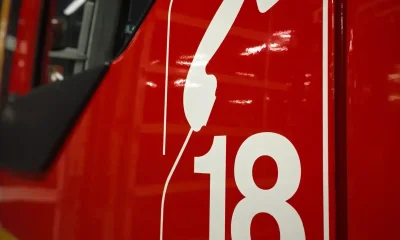En ce début d’été caniculaire, les premières remontées inquiètent : dans plusieurs départements — de la Charente-Maritime aux Vosges — les pompiers interviennent régulièrement pour circonscrire ces départs de feu en pleine moisson. Dans la majorité des cas, le feu prend dans les chaumes, ces résidus de culture extrêmement inflammables.
Ces feux peuvent parcourir jusqu’à un hectare par minute lorsque les conditions sont réunies : chaleur, sécheresse, vent. L’été dernier, un feu de récolte dans l’Aube avait ravagé plus de 60 hectares de cultures en moins de deux heures.
Des causes multiples, souvent humaines
Dans neuf cas sur dix, ces incendies sont provoqués par une activité humaine : un échappement surchauffé, une moissonneuse mal entretenue, un mégot jeté depuis une route ou encore une simple étincelle. Parfois, le départ de feu se produit sans que l’agriculteur s’en aperçoive, à l’arrière d’un engin.
« Il suffit d’un roulement à bille mal graissé pour mettre le feu à tout un champ », explique un exploitant de la Beauce, confronté à un sinistre en 2024. « Heureusement, j’avais ma tonne à eau à portée. Mais ça va très vite. »
Une vigilance de chaque instant
Face à la montée du risque, les chambres d’agriculture et les préfectures multiplient les messages d’alerte. L’objectif : inciter les agriculteurs à préparer leurs moissons comme on prépare une campagne de lutte contre le feu.
Parmi les recommandations :
- Déchaumer régulièrement les bordures de champ pour créer des zones coupe-feu.
- Moissonner à contre-vent.
- Équiper chaque engin d’un extincteur.
- Maintenir une citerne ou tonne à eau sur le terrain.
Dans certains départements comme le Cher, un arrêté préfectoral impose même ces mesures en période de vigilance renforcée.
Une saison à haut risque
Depuis quelques années, le calendrier des feux s’allonge. Désormais, les premiers départs peuvent survenir dès le mois de juin, voire fin mai, et la saison s’étend parfois jusqu’en septembre. Le changement climatique y est pour beaucoup : les périodes de sécheresse s’intensifient et les vents d’été deviennent plus fréquents.
« Nous sommes passés d’un été de vigilance à un été de crise permanente », résume un officier. « Les feux de récolte sont plus discrets que les incendies de forêt, mais ils sont tout aussi dangereux. »
En première ligne : les agriculteurs
Pour ces derniers, l’enjeu est double : protéger leur outil de travail… et éviter que le feu ne gagne les zones boisées voisines. En bordure de garrigue ou de pinède, un simple feu de chaume peut rapidement tourner au cauchemar.
« Chaque année, je travaille avec la boule au ventre. Dès que la moissonneuse démarre, je regarde le ciel, j’écoute le vent, je scrute le moindre nuage de fumée », confie un céréalier. « Ce n’est plus seulement une moisson. C’est une course contre le feu. »
En cas de départ de feu : les bons réflexes
Les pompiers rappellent qu’en cas d’incendie :
- Il faut appeler immédiatement le 18 ou le 112.
- Préciser la localisation exacte (nom du champ, coordonnées GPS, accès).
- Ne pas prendre de risques inconsidérés.
Une menace durable
Si la grande majorité des feux de récolte restent contenus, leur multiplication inquiète. En 2024, plus de 4 000 hectares de cultures sont partis en fumée en France, rien qu’en juillet. Pour les exploitants, c’est aussi un enjeu économique, avec des pertes parfois non assurées, notamment lorsque le feu est auto-provoqué.